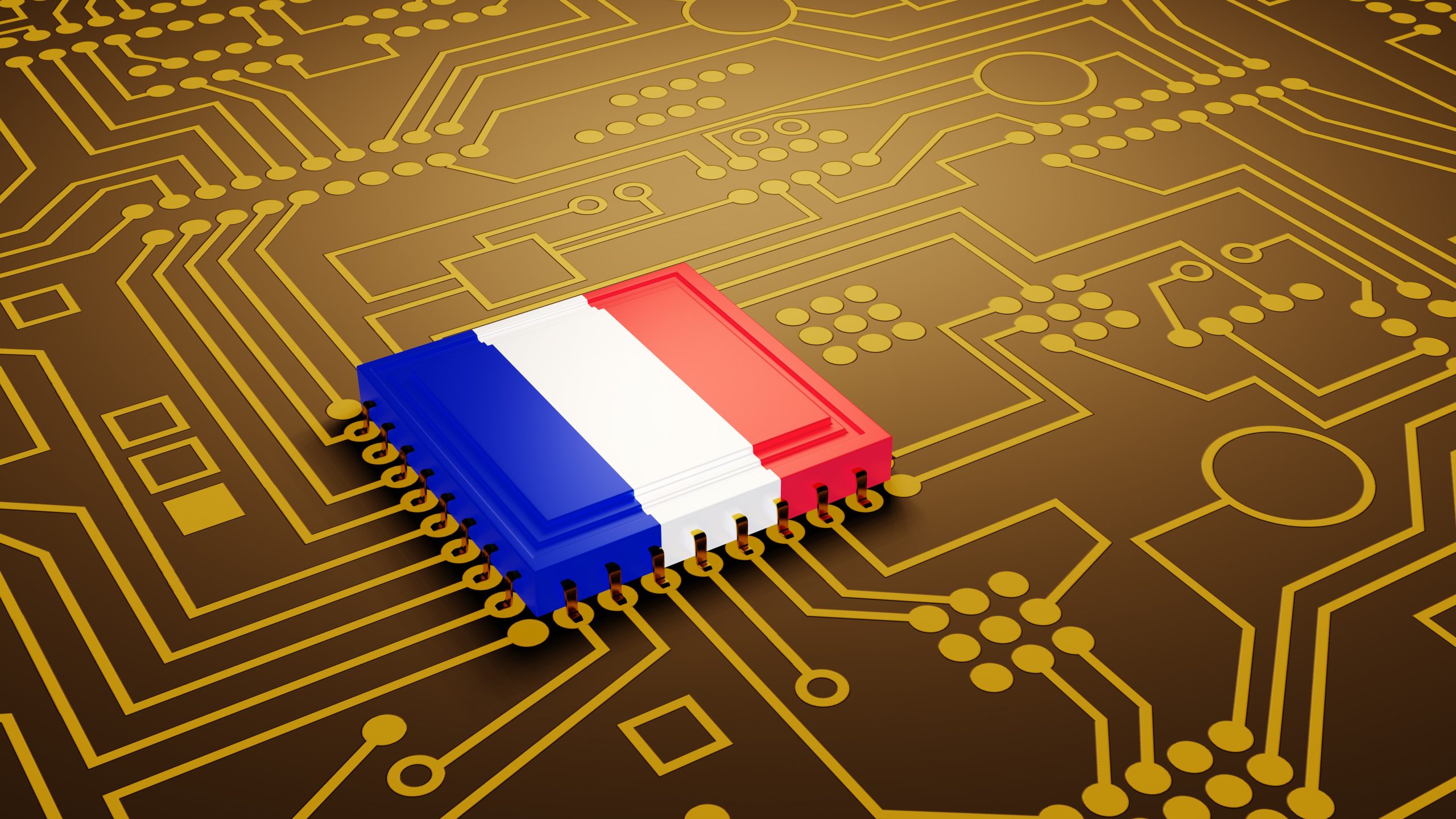Selon le rapport du Sénat, « L’intelligence artificielle et les professions du droit », le développement de l’intelligence artificielle générative appliqué au droit s’est accéléré en France depuis l’année dernière. L’activité des éditeurs et des entreprises de legal tech s’est en effet organisée et structurée en 2024, au prix de « lourds investissements » pour les éditeurs de solution. La croissance de ces activités est portée notamment par les besoins en recherches juridiques améliorées et en gestion de contrat.
Malgré cette accélération, où se situe vraiment la France? Que ce soit dans les investissements, l’offre de marché ou dans les usages? Selon les analyses et experts de l’IA, le secteur juridique français est un peu à la traîne d’autres pays européens qui ont pris le virage de l’IA. « La France accuse du retard par rapport aux États-Unis ou à la Chine. En Europe, la situation est un peu différente, si le Royaume-Uni et l’Allemagne sont en avance, il y a eu des mouvements ces dernières années. Néanmoins dans le secteur juridique, on peut relever des disparités entre Paris et la province ».
En termes d’investissements, la France accuse un certain retard. « Certains pays sont plus dynamiques car ils bénéficient d’investissements ciblés », relève Félix Humbaire, partner spécialiste de l’IA chez Eurogroup Consulting. Par exemple le Royaume-Uni a lancé une initiative spécifique baptisée Lawtech UK. En France, la profession juridique reste encore en marge des grandes stratégies nationales.
En termes d’usages, les directions juridiques semblent se convertir. Selon une étude PWC, Cercle Montesquieu et France Digitale auprès des directeurs juridiques, 71% des répondants utilisent l’IA générative dans leurs recherches juridiques et 30% pour la gestion des contrats. Ces deux piliers tirent les usages que ce soit en entreprises ou dans les cabinets.
Un coût difficile à absorber pour un secteur juridique très fragmenté
Mais le passage à l’IA a un coût, ce qui peut expliquer les retards à l’allumage. Il existe un effet d’échelle : il est plus facile de rentabiliser des investissements en IA dans de grandes structures que dans de petits cabinets, parfois unipersonnels. « Le secteur juridique est très fragmenté. On compte de nombreux avocats exerçant dans de petites structures, alors qu’un investissement en IA nécessite une certaine massification », explique Félix Humbaire. Pour ces petits cabinets, des solutions « sur étagère » avec une personnalisation minimale sont souvent privilégiées, et elles restent encore peu matures.
Il faut aussi y voir une différence de culture ou de mentalité. De nombreux analystes, qu’ils soient du sérail ou non, relèvent en effet un conservatisme important de la profession juridique. « Il y a quelques années, la profession était dans une posture défensive contre les « braconniers du droit » – ces acteurs non-avocats proposant des services juridiques automatisés. Cette réaction protectionniste s’expliquait par la volonté de préserver le monopole de la consultation juridique, considérée comme indissociable de la déontologie et de l’expertise de l’avocat. », rappelle Abel Sabeur, avocat chez Legal First avocat et pionnier dans le domaine. « Les juristes sont souvent spécialisés dans un seul domaine d’expertise. Il est plus rare qu’ils soient « hybridés » , c’est-à-dire qu’ils cumulent un second rôle, même si des fonctions de Legal Ops commencent à émerger », ajoute Félix Humbaire. On relèvera aussi l’importance de la confidentialité et de la protection des données clients pour les professions juridiques.
Accompagner l’outil par des transformations organisationnelles
Enfin, selon ce spécialiste de la transformation par l’IA, le retard s’explique également par la nécessité d’accompagner l’introduction de ces outils par des transformations organisationnelles majeures, et de ne pas se limiter à la simple implantation technologique. Selon l’étude sur l’IA Générative, réalisée récemment par Eurogroup Consulting auprès de 46 organisations, si l’IA suscite beaucoup d’intérêt, son intégration dans les pratiques reste encore nouvelle : 95 % des projets sont à un stade « pilote » ou en cours de passage à l’échelle. L’étude relève encore que les gains de productivité perçus sont davantage individuels plutôt qu’ils ne bénéficient à l’organisation tout entière.
Pour accélérer le développement de l’IA au sein des professions juridiques (avocats, notaires, directions juridiques, etc), un changement de posture est nécessaire. « Plutôt que de combattre l’inévitable transformation numérique, mieux vaut tenter de la maîtriser, enjoint Abel Sabeur. « Mais si l’innovation est déléguée à des acteurs externes, la profession pourrait perdre son rôle central dans l’écosystème juridique ».